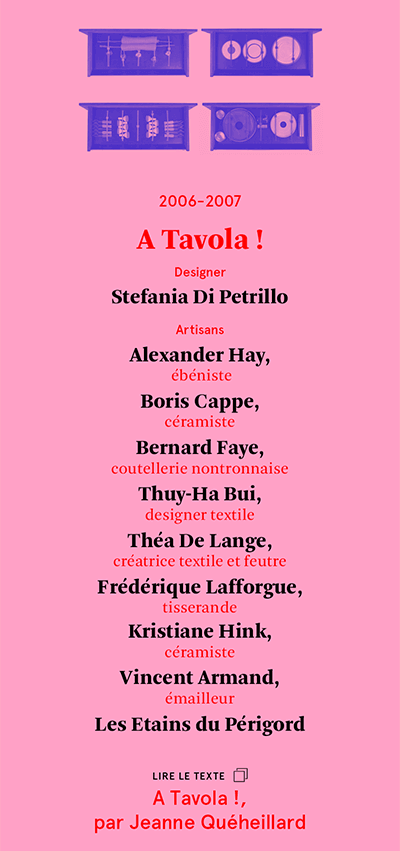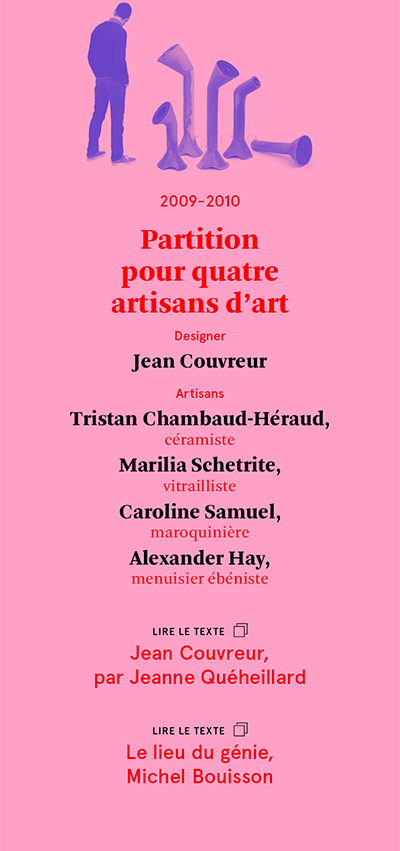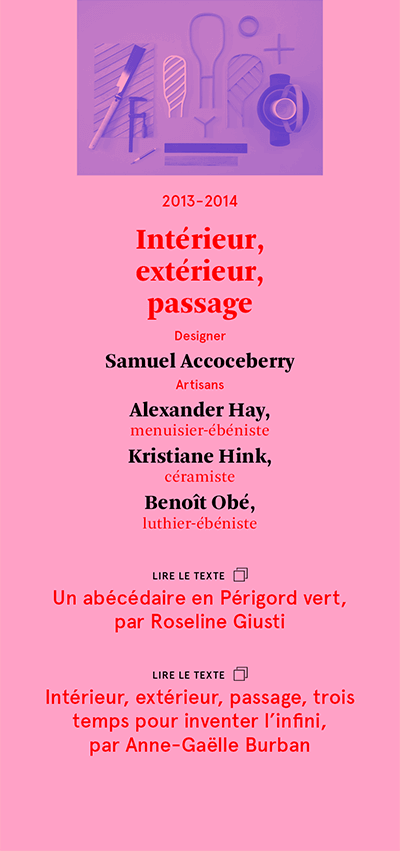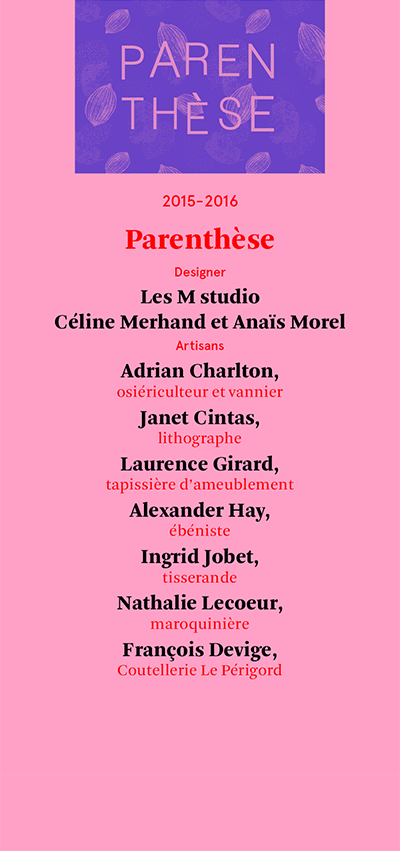d’art dans le cadre du programme
des « Résidences de l’Art Dordogne ».
Récits d’expériences de 2000 à 2016.
Le programme des « Résidences de l’Art en Dordogne »
offre à des artistes plasticiens ou designers (exclusivement
à Nontron) un temps de recherche et de création inspiré
des spécificités géographique, paysagère, économique
ou culturelle du département. Ce dispositif est coordonné
par l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord,
et soutenu par le Conseil départemental de la Dordogne,
le Ministère de la Culture et de la Communication/DRAC
Nouvelle-Aquitaine et le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine.
À Nontron, Le Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron
et du Périgord-Limousin accueille les designers en résidence
avec le soutien de la communauté de communes du Périgord
Vert Nontronnais et le mécénat du Garage Peugeot 2 000 sarl
de Nontron. Les recherches incitent à de nouveaux types
de production pour les designers et pour les artisans
des métiers d’art.

de Nontron et du Périgord-Limousin :
valorisation des métiers d’art
et développement culturel local.
Situé à la croisée de la Dordogne, de la Haute-Vienne
et de la Charente, le Pôle Expérimental Métiers d’Art
de Nontron (PEMA, association loi 1901) soutient en priorité
la création contemporaine dans les métiers d’art.
Il s’appuie sur un territoire rural riche en ressources naturelles
(bois, minerai, eau, etc.) et une longue tradition artisanale.
Forges, coutelleries, industries du feutre et du chausson,
ébénisteries et fabricants de sabots, etc. s’y déployaient jusqu’au
xxe siècle. Certaines manufactures perdurent encore.
Nous assistons aujourd’hui à un renouveau avec les industries et
artisanats du luxe (Hermès, CDW – sellerie nontronnaise, Ayrens,
Tannerie de Chamont, Coutellerie nontronnaise, Coutellerie Le
Périgord, Repetto, Chamberlan, etc.). Plus
de 300 ateliers métiers d’art sont installés en Périgord Vert.
Ceci s’est accompli avec la volonté tenace des acteurs locaux
et des collectivités territoriales qui ont multiplié les initiatives
tant économiques que culturelles : aide à l’installation
ou à la rénovation d’entreprises, organisation et soutien
de manifestations telles que la Fête du Couteau à Nontron,
la Foire des Potiers de Bussière-Badil, le salon Rue des Métiers
d’Art à Nontron, le Marché des Tisserands à Varaignes ou le
salon des Portes du Cuir qui, au-delà de la vitrine commerciale,
sont aussi des lieux de rencontres entre professionnels.
Le PEMA est un des leviers essentiels de cette dynamique. Il
organise des expositions qui valorisent la diversité et la créativité
des métiers d’art. Elles sont un terrain propice au dialogue
entre métiers d’art, design et art contemporain : Primaires !
(avec Ateliers d’Art de France, 2013), Partage d’Intime (avec
le Frac Aquitaine, 2016), Pol Chambost – sculpteur, céramiste,
designer (2016), etc. Il soutient concrètement les métiers d’art,
à travers des formations et en commercialisant les créations.
En 1999, le PEMA s’est distingué très tôt dans le paysage
culturel et artisanal français en s’appuyant sur le réseau
des « Résidences de l’Art en Dordogne », pour accueillir
des designers en résidence. Designer et professionnels
métiers d’art partagent leurs savoirs, savoir-faire et
expériences. La résidence se conclue par des créations
communes, voire l’édition de nouveaux produits.
La résidence offre au designer dans la plus grande liberté,
un nouveau terrain d’expression et l’opportunité d’interroger
de nouvelles formes, matériaux ou fonctions, à travers des
pièces uniques ou des petites séries. Dans ce contexte précis,
les professionnels métiers d’art renoncent à une part de leur
identité créative. Restent l’atelier, la gestuelle, les techniques
et les outils. Pour eux, la valeur ajoutée de la résidence se
loge dans le questionnement de leur outil de travail et de leur
personnalité. Elle agit comme révélateur. Ce renouvellement
génère un supplément de technicité et d’expérience appropriable
par l’artisan qui le réinvestit dans ses créations personnelles.
Les résidences design et métiers d’art à Nontron sont
l’expérience de la rencontre et de l’échange et le défi du
dialogue. C’est là que de toute évidence résident la réussite
de ce programme et l’élan créatif qui en résulte.

et les professionnels des métiers
d’art de Nontron.
La géographie a une histoire.
À son retour de l’exposition universelle du Crystal Palace
à Londres en 1851, le comte Léon de Laborde, conservateur
au Louvre, rédigea un rapport * qui prônait la collaboration
des artistes et des artisans et un rapprochement entre l’art et
l’industrie. Bien que peu écouté en France, il se faisait cependant
l’écho des thèses et des débats portés par William Morris et Henri
Cole en Angleterre et par Henry Van de Velde, Walter Gropius
et Muthesius en Allemagne. Cette action conjuguée des artistes,
des artisans ou des industriels, modélisée ensuite par le Bauhaus,
visait au dépassement
des modèles artisanaux par une industrie qui se devait d’inventer
ses propres modèles. La révolution industrielle introduisait
des changements notoires. La possibilité de produire le même
objet en grande quantité s’est accompagnée d’un découpage
« rationnel » des tâches de fabrication. L’usine
va remplacer l’atelier, l’artisan/concepteur va devoir scinder
sa pratique, entre l’exercice d’un savoir-faire et l’activité
de conception. Pour répondre à ces changements, les artistes
ont soutenu les hiatus de cette révolution, soit qu’ils ont exploré
les promesses de la machine industrielle soit qu’ils se sont
opposés au principe d’une standardisation risquant d’effacer le
génie créateur, se faisant par là les défenseurs d’une œuvre d’art
totale telle que les pratiques artisanales pouvaient le permettre.
Ils se sont largement mobilisés pour produire un art social et faire
des arts décoratifs un art du quotidien, inaugurant par là une
nouvelle classe de créateurs, les designers, et un nouveau champ
esthétique de production, le design.
Le pôle des métiers d’art de Nontron connaît cette épopée des
deux siècles passés, et reconnaît les transformations irréversibles
auxquelles sont confrontées les pratiques artisanales. En invitant
des designers sur le terrain des artisans métiers d’art, il permet
que s’opère un déplacement réciproque.
Libres d’une exigence de production, les designers/artistes
se font les interprètes d’un contexte artisanal qui a priori semble
éloigné de leurs expériences industrielles dont ils importent
cependant la méthode de projet. Matali Crasset
a assumé une place de chef de projet en réunissant des artisans
de différents secteurs et en installant les conditions d’une
production commune à partir d’un module de base identique.
Godefroy de Virieu a développé une nouvelle typologie
d’objets à partir d’une utilisation vernaculaire du châtaignier.
Stéfania Di Petrillo insiste sur la part symbolique d’un objet
en convoquant dix métiers pour dresser une table, boîte
ambassadrice des savoirs-faire d’une communauté.
Jean Couvreur refuse de se soumettre aux contraintes admises
des matériaux et les explore dans des limites inhabituelles pour
étendre leurs capacités d’utilisation. Samuel Accoceberry
combine des éléments-volumes en bois ou en céramique
pour créer des séries différenciées et des pièces uniques.
Les M Studio travaillent à l’édition d’objets avec et pour
des artisans très divers, qui font la géographie artisanale
de Nontron.
En retour, les professionnels des métiers d’art connaissent
de manière très spécialisée un matériau, des gestes,
des outils et des techniques qu’ils confrontent aux capacités
de recherche, d’innovation et d’invention des designers.
À l’heure où la civilisation industrielle intègre tout type
de productions matérielles et immatérielles, en série
ou en pièce unique, où elle utilise des nouvelles technologies
comme des technologies ancestrales, l’environnement
artisanal des métiers d’art met à disposition d’une manière
très proche dite locale, une variété et une hétérogénéité
de pratiques. La scission des tâches initialement provoquée
par la révolution industrielle, entre l’exercice d’un savoir-faire
et l’activité de conception, est déjouée par une collaboration
designers/artistes/artisans riche en expérience. Une mise
en œuvre directe et concrète matérialise des rêveries inédites.
L’approche patrimoniale de la conservation des savoirs-faire
se renverse au profit d’une actualité des savoirs. Il y a dans
ce revirement l’espérance d’une forme critique à travers
le devenir industriel de l’homme artisan selon la terminologie
du sociologue Richard Sennett. L’approche R & D (recherche
et développement) prend une voie nouvelle dans laquelle
l’artisan retrouve une légitimité, non pas vers un devenir artiste
revendiqué depuis le xixe siècle, mais vers un devenir chercheur
dans un monde qui a pu croire en sa dématérialisation.
Grâce à un circuit de production court permettant de relier
des savoirs conservés à des outils et des langages contemporains,
l’approche sensible du designer/artiste rejoint celle de l’artisan à
travers une expérience de co-création
sur un modèle horizontal de partage des savoirs.
Loin d’être obsolètes, ces préoccupations trouvent
une nouvelle réalité.
* - Léon de Laborde, De l’Union des Arts et de l’Industrie, 1856